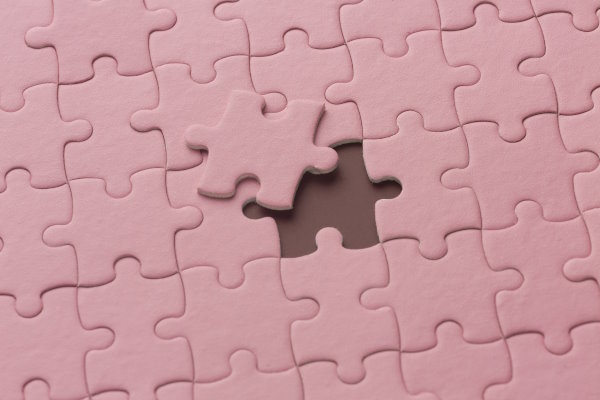Les TCC augmentées par Hypnothérapie :
Apports mécanistiques, preuves cliniques et intégrations stratégiques.
Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) font partie des approches les plus validées scientifiquement pour traiter l’anxiété, la dépression ou encore les troubles liés au stress. L’hypnose clinique, de son côté, est reconnue pour sa capacité à moduler l’attention, la mémoire émotionnelle et la régulation physiologique. Associer hypnose et TCC ouvre la voie à des thérapies dites augmentées, qui cherchent à optimiser l’efficacité des protocoles tout en favorisant l’alliance thérapeutique. Cet article explore les mécanismes, les preuves cliniques et les perspectives d’intégration stratégique de l’hypnose au sein des TCC.
1. Introduction
Depuis plusieurs années, les thérapies comportementales et cognitives (TCC) évoluent pour répondre à des besoins cliniques toujours plus complexes, intégrant de nouvelles modalités d’intervention afin d’accroître leur efficacité et leur portée. Le 53ᵉ congrès1 de l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC) met ainsi à l’honneur le concept de « TCC augmentée », c’est-à-dire l’enrichissement des approches standardisées par des leviers complémentaires : intensification protocolaire, réalité virtuelle, utilisation de substances psychédéliques, dispositifs numériques ou encore intelligence artificielle. Ces propositions traduisent une intuition juste : pour certains patients2, surtout dans les cas complexes ou résistants, le changement thérapeutique exige d’intervenir au-delà du seul raisonnement conscient, en modulant les états internes et les dynamiques attentionnelles, émotionnelles et corporelles.
Dans cette cartographie des innovations, cet oubli interroge. En effet, loin des représentations spectaculaires ou « ésotériques », l’hypnose clinique3 repose sur des mécanismes neurocognitifs identifiés et sur un cadre interactionnel précis, articulable depuis longtemps avec la démarche cognitive et comportementale. Elle n’exige ni dispositif lourd, ni molécule, mais mobilise les ressources internes du patient pour créer toutes les conditions d’un changement dirigé : focalisation attentionnelle, modulation de la connectivité entre réseaux cérébraux (notamment réseau du mode par défaut, réseau exécutif et réseau de saillance), régulation émotionnelle et accès facilité aux représentations mnésiques [ Jensen & Patterson (2014), Terhune et al. (2017) ].
En outre, son mode d’action répond à l’une des problématiques centrales que la TCC augmentée cherche à résoudre : comment créer un état neuropsychique favorable au changement sans recourir à une technologie immersive ni à une substance pharmacologique ? Des données récentes suggèrent un intérêt de l’hypnose en comparaison ou en adjonction à la TCC : un essai randomisé (n = 66) n’a pas mis en évidence de différence significative sur les mesures continues entre TCC et TCC + hypnose, mais a observé, chez les compléteurs, un taux de rémission à 12 mois plus élevé dans le bras combiné TCC + hypnose (p = .011, n = 66) ; résultat exploratoire nécessitant réplication. D’autres travaux comparant hypnothérapie et TCC sans adjonction montrent des améliorations des améliorations symptomatiques comparables [ Haipt et al. (2024), Ramondo et al. (2024) ] ; au plan neurofonctionnel, des indices (exploratoires, non robustes après correction) suggèrent sous hypnothérapie une modulation du réseau du mode par défaut, possiblement distincte de celle observée sous TCC, point à confirmer par des études mécanistiques de plus grande puissance.
Au-delà de l’efficacité symptomatique, plusieurs auteurs et praticiens considèrent que l’hypnose agit comme un levier expérientiel : elle ne modifierait pas seulement le contenu cognitif, mais l’état qui rend possible sa transformation. Cette modulation d’état pourrait constituer ce qui manque parfois aux approches strictement procédurales : le patient peut « savoir » ce qu’il devrait penser ou faire pour aller mieux, tout en restant incapable de l’éprouver, de l’incarner et d’agir en fonction – ou de mettre en place les comportements adéquats conduisant au changement. L’hypnose, en tant que levier expérientiel, offre potentiellement ce pont entre compréhension et vécu, rendant praticable ce qui, jusque-là, restait conceptuel.
Loin des usages approximatifs parfois associés au mot « hypnose », il s’agit ici d’hypnose clinique pratiquée dans un cadre rigoureux, exigeant une formation approfondie, une supervision continue et un ancrage éthique. C’est dans ces conditions seulement que son intégration aux TCC peut prétendre à une réelle valeur ajoutée.
L’objectif de cet article est donc de réinscrire l’hypnose clinique dans le champ des TCC augmentées, en articulant :
- ses fondements mécanistiques,
- les preuves empiriques récentes de son efficacité,
- ses articulations stratégiques avec les protocoles TCC,
- et enfin une illustration clinique de son apport dans un cas complexe.
Définition opérationnelle de l’hypnose clinique
Hypnose clinique : dispositif thérapeutique structuré visant l’induction volontaire d’un état de conscience modifié, caractérisé par une :
- focalisation attentionnelle intense et réduction du champ de vigilance périphérique ;
- augmentation de la suggestibilité psychophysiologique, dans un cadre relationnel sécurisé ;
- modulation neurocognitive des réseaux attentionnels, émotionnels et sensoriels ;
- co-conscience4 maintenue ou modulée selon l’objectif thérapeutique.
Contrairement à l’hypnose de spectacle et de rue par exemple, l’hypnose clinique repose sur des techniques interactionnelles, verbales et expérientielles visant des changements ciblés et mesurables.
Hypnose et TCC : une compatibilité de paradigmes
| Dimension TCC | Apport spécifique de l’hypnose |
|---|---|
| Restructuration cognitive | Facilite l’accès aux représentations alternatives via un état propice au changement. |
| Exposition graduée | Permet des simulations sécurisées et engageantes avant l’exposition in vivo. |
| Activation comportementale | Relance l’imaginaire et la motivation dans les dépressions inhibées. |
| Régulation émotionnelle | Offre des stratégies expérientielles pour moduler l’activation physiologique. |
| Reconsolidation mnésique | Crée un contexte attentionnel et émotionnel favorable à la mise à jour des souvenirs et émotions associées, afin de les réencoder avec de nouvelles valences ou intensités émotionnelles plus apaisées. |
2. Fondements théoriques et mécanistiques
2.1. Définition opérationnelle et périmètre
Dans le cadre de cet article, l’hypnose clinique désigne donc une pratique thérapeutique rigoureuse qui se distingue clairement des formes spectaculaires ou récréatives souvent véhiculées dans l’imaginaire collectif. Elle s’ancre dans un dispositif relationnel précis et dans un travail structuré sur l’expérience subjective, visant à induire, de manière volontaire et collaborative, un état de conscience modifié. Cette induction peut prendre des formes très variées – permissive, directive, formelle ou implicite – mais elle repose toujours sur une construction relationnelle active. Ce n’est pas un « script » appliqué mécaniquement, mais un processus cocréé, qui tient compte des capacités attentionnelles, sensorielles et imaginatives de la personne, ainsi que de son contexte émotionnel et narratif. Cet état, loin d’un sommeil ou d’un abandon passif, se caractérise par une focalisation intense de l’attention et une réduction concomitante du champ de vigilance périphérique, créant les conditions d’une immersion contrôlée dans un contenu mental ou sensoriel. Cette immersion n’a pas pour finalité de couper la personne du réel ou de la conscience de soi, mais de moduler sélectivement la place occupée par certaines perceptions ou représentations. Elle peut ainsi fonctionner, dans certains contextes, comme une forme d’exposition imaginale préparatoire, suffisamment contenue pour rester tolérable, mais assez activante pour ouvrir un espace interne malléable. Ce réglage du « focus » attentionnel crée alors les conditions pour aborder des contenus difficiles tout en préservant un sentiment de sécurité interne.
Les travaux récents en neurosciences cognitives montrent que cet état hypnotique ne se limite pas à un vécu subjectif particulier : il s’accompagne de modifications mesurables de la connectivité cérébrale, notamment au sein du réseau du mode par défaut (default mode network, DMN), du réseau exécutif central (central executive network, CEN) et du réseau de saillance (salience network, SN)5. Ces ajustements dynamiques facilitent la suspension transitoire de certains filtres cognitifs et émotionnels, ouvrant l’accès à des représentations ou à des schémas de réponse qui restent habituellement inaccessibles dans l’état de vigilance ordinaire [ Oakley & Halligan (2013), Terhune et al. (2017) ]. Ainsi, l’hypnose clinique agit moins comme une technique d’influence directe que comme un cadre expérientiel où la perception, la mémoire et l’émotion peuvent être modulées en fonction d’objectifs thérapeutiques précis, dans le respect de l’autonomie du sujet. Ce point est d’ailleurs essentiel : l’hypnose clinique n’est pas un moyen de « faire faire » mais un cadre qui facilite l’accès à des états internes favorables au changement. La personne reste actrice du processus, consciente de ses choix et capable d’interrompre l’expérience à tout moment.
2.2. Mécanismes neurocognitifs
L’hypnose clinique n’agit pas dans un vide physiologique : plusieurs études de neuroimagerie fonctionnelle et de synthèse indiquent qu’elle peut s’accompagner de modulations au sein de réseaux cérébraux impliqués dans l’attention, la régulation émotionnelle et le traitement mnésique. Des travaux ont notamment rapporté des modifications de connectivité dans le réseau du mode par défaut, le réseau exécutif central et, selon les paradigmes, certaines structures du réseau de saillance (p. ex., insula) ; cependant, ces résultats demeurent hétérogènes et parfois exploratoires, certains effets initialement significatifs n’ayant pas résisté aux corrections pour comparaisons multiples [ Haipt et al. (2024), Jensen & Patterson (2014), Landry et al. (2017), Wolf et al. (2022) ].
L’hypothèse la plus fréquemment avancée est que l’état hypnotique facilite la suspension transitoire de certains filtres cognitifs et émotionnels, ce qui pourrait réduire l’intrusion des processus auto-référentiels (pensées centrées sur soi, comme la rumination) et accroître la disponibilité attentionnelle et intéroceptive. En modulant l’activation émotionnelle et en ouvrant l’accès à des représentations alternatives, l’hypnose favorise une plus grande flexibilité mentale. Cette aptitude à sortir de schémas figés – qu’il s’agisse de rumination, de dissociation ou d’évitement – conditionne la possibilité même d’un apprentissage thérapeutique durable. Cette modulation d’état est comparable, dans sa fonction, à ce que recherchent certaines modalités d’ « augmentation » récentes comme la réalité virtuelle, le propranolol ou les psychédéliques, mais elle s’obtient ici sans dispositif technique ni altération pharmacologique.
Sur le plan des thérapies comportementales et cognitives, ces ajustements neuronaux – encore à documenter de manière robuste – pourraient contribuer à réduire l’emprise des boucles auto-référentielles6 et à favoriser une présence accrue aux signaux internes, créant un terrain propice à l’extinction conditionnée, à la mise à jour des souvenirs émotionnels et à l’inhibition de réponses comportementales (ouvertes ou fermées) automatisées. L’intérêt ne réside pas seulement dans la facilitation de l’évocation d’images ou de souvenirs : l’hypnose modifie l’état global dans lequel ces contenus sont traités, ce qui peut influencer la manière dont ils sont réencodés. C’est cette interaction entre état interne et reconsolidation mnésique qui pourrait contribuer à expliquer, au moins en partie, pourquoi certaines expériences vécues en hypnose s’accompagnent de changements durables.
L’hypnose n’ajoute pas simplement un « module » à un protocole TCC : elle transforme l’architecture attentionnelle et émotionnelle dans laquelle ce protocole s’inscrit, augmentant ainsi – dans certains cas – sa capacité à produire un changement durable. Elle ne se réduit donc pas à une technique suggestive, mais constitue un modulateur d’état neurocognitif qui peut optimiser le terrain sur lequel les TCC opèrent, en particulier lorsque les approches classiques peinent à franchir certains seuils expérientiels.
Hypnose et neuroplasticité en TCC
L’hypnose clinique peut être comprise comme un outil d’accès à la plasticité cérébrale dans un cadre thérapeutique structuré. En modulant l’état attentionnel et émotionnel du patient, elle crée un contexte favorable à la mise à jour de réseaux mnésiques et comportementaux. Cette capacité rejoint les objectifs des TCC, qui cherchent à remplacer des schémas dysfonctionnels par des alternatives plus adaptatives.
2.3. Compatibilité paradigmatique avec les TCC
Loin de constituer un paradigme concurrent, l’hypnose clinique s’inscrit dans une continuité méthodologique avec les thérapies comportementales et cognitives. Ce n’est pas une approche alternative qui viendrait remplacer ou concurrencer les protocoles existants, mais un dispositif permettant de moduler l’état interne dans lequel ces protocoles prennent place. La logique de l’intégration repose sur une idée simple : pour que les techniques TCC puissent produire leur effet – qu’il s’agisse d’exposition, de restructuration cognitive ou d’activation comportementale – encore faut-il que le patient se trouve dans une configuration attentionnelle et émotionnelle qui rende l’expérience possible et tolérable. Dans la pratique, cela signifie que l’hypnose agit comme un ajusteur de contexte : elle élargit la « fenêtre de tolérance » émotionnelle et physiologique du patient, condition indispensable pour que les techniques TCC puissent s’appliquer pleinement. Sans cet ajustement, certaines interventions – pourtant pertinentes sur le plan théorique – restent inopérantes car elles se heurtent à des défenses automatiques ou à une sidération corporelle.
Dans cette perspective, l’hypnose agit comme un régulateur dynamique des seuils de perception, de contrôle et d’ouverture. En phase préparatoire, elle peut réduire l’hyperactivation physiologique ou installer un sentiment de sécurité, condition préalable à toute exploration émotionnelle. Au cœur de la thérapie, elle facilite l’accès à des contenus jusque-là inaccessibles ou fragmentés, en permettant que ceux-ci soient abordés sans sidération ni fuite dissociative. En phase de consolidation, elle renforce l’ancrage mnésique des apprentissages et favorise leur transférabilité dans la vie quotidienne, parfois au moyen de techniques d’auto-hypnose. Cette modulation ne doit toutefois pas être confondue avec une stratégie de réassurance : l’objectif n’est pas d’éteindre l’émotion, mais de permettre qu’elle soit vécue à une intensité tolérable, afin que le processus d’exposition conserve sa valeur thérapeutique7. En ce sens, l’hypnose n’a pas pour fonction de neutraliser ou d’édulcorer l’expérience émotionnelle : elle vise à maintenir l’activation à un niveau optimal pour l’apprentissage inhibiteur. Autrement dit, l’émotion reste suffisamment mobilisée pour que les mécanismes d’extinction et de reconsolidation puissent s’opérer, mais sans franchir le seuil de sidération qui bloque le traitement de l’information. Et, à cet égard, l’intégration de la pleine conscience dans les TCC de troisième vague constitue un précédent significatif : elle montre que des outils expérientiels initialement extérieurs au corpus cognitivo-comportemental peuvent enrichir le cadre sans le dénaturer. L’hypnose peut être envisagée, de façon parallèle, comme une modalité de modulation d’état interne, fonctionnellement comparable mais encore peu explorée dans ce champ.
Ce rôle de « modulateur d’état » explique pourquoi l’hypnose clinique s’articule naturellement avec les objectifs des TCC. On en trouve des exemples formalisés dans la Cognitive Hypnotherapy développée par Alladin (2007) pour le traitement de la dépression majeure, où les interventions hypnotiques soutiennent la restructuration cognitive et la relance motivationnelle, ou encore dans le protocole HYP-CT© de Jensen pour la douleur chronique, qui associe induction hypnotique, travail sensoriel et exercices comportementaux ciblés. Dans chacun de ces cadres, l’hypnose ne modifie pas la destination du traitement, mais en optimise les conditions de parcours, en réorientant les ressources internes du patient vers l’expérience thérapeutique plutôt que vers la défense ou l’évitement. En ce sens, elle ne change pas la logique du protocole TCC, qui repose déjà sur l’engagement actif du patient, mais elle en transforme la dynamique interne : les techniques cognitives et comportementales peuvent être mises en œuvre dans un état où l’expérimentation devient plus accessible, parfois même engageante.
Trois leviers partagés entre hypnose et TCC
| Levier | Action en hypnose | Effet recherché en TCC |
|---|---|---|
| Modulation attentionnelle | Focalisation sélective, réduction des distracteurs | Concentration sur la tâche thérapeutique |
| Activation sensorielle | Amplification d’images, sons, sensations | Faciliter l’apprentissage expérientiel ainsi que l’exposition en imagination |
| Réorganisation mnésique | Modification des liens entre souvenir et émotion | Reconsolidation adaptative |
Ces trois leviers ne sont pas théoriques : ils se retrouvent dans la majorité des intégrations réussies de l’hypnose aux TCC, qu’il s’agisse de protocoles standardisés ou de pratiques plus souples adaptées à chaque contexte clinique.
3. Données empiriques
L’examen de la littérature scientifique récente montre que l’hypnose clinique bénéficie d’un socle de données empiriques, y compris lorsque son usage est intégré à des protocoles de thérapies comportementales et cognitives. Ces données proviennent à la fois de revues systématiques et de méta-analyses portant sur des catégories de troubles variées, et d’essais contrôlés randomisés ciblant l’association TCC + hypnose dans des indications précises.
Sur le plan transversal, Rosendahl et al. (2024) synthétisent 49 méta-analyses couvrant plus de vingt ans de recherches et rapportent des effets positifs de l’hypnose comparée à des contrôles de bras non actifs ou actifs, pour la plupart des troubles étudiés – anxieux, dépressifs, somatoformes ou liés à la douleur – avec une hétérogénéité substantielle. Les effets les plus robustes concernent la douleur et les procédures médicales ; les auteurs soulignent la nécessité de comparaisons directes avec des interventions psychologiques établies.
Ce panorama général recoupe certaines conclusions de la revue systématique de Jones et al. (2024) portant sur plus de soixante-dix essais cliniques dans la douleur chronique : l’ajout d’un module hypnotique aux soins habituels produit des effets additionnels modestes, parfois modérés lorsqu’il est combiné à de l’éducation ou à un traitement pharmacologique. La certitude globale des preuves est toutefois très faible, et les effets sur la plupart des critères secondaires (fonctionnement, anxiété, sommeil) sont limités, avec un petit bénéfice à trois mois lorsque l’hypnose est combinée à des interventions psychologiques.
Les études ciblant directement l’association TCC + hypnose apportent des précisions intéressantes. Dans un essai randomisé contrôlé mené auprès de patients souffrant de dépression majeure, Ramondo et al. (2024) ont comparé un protocole TCC standardisé à une TCC intégrant des modules hypnotiques à visée de régulation émotionnelle et de projection imaginale. Les analyses n’ont pas mis en évidence de différence significative sur les mesures continues (post, 6 et 12 mois) ; toutefois, chez les compléteurs, la proportion de rémissions à 12 mois était plus élevée dans le groupe TCC + hypnose (p = .011). Ce signal, à confirmer, pourrait refléter un effet sur l’engagement et la mobilisation motivationnelle, dimension qui bloque souvent la progression dans les cas cliniques où la compréhension cognitive ne suffit pas.
Sur le plan mécanistique, l’étude de Haipt et al. (2024) apporte un éclairage exploratoire par neuroimagerie fonctionnelle. Comparant les effets cérébraux de la TCC et de l’hypnothérapie dans la dépression, les auteurs constatent des améliorations symptomatiques comparables, ainsi que des indices de modulation du réseau du mode par défaut spécifiques à l’hypnose, mais non robustes après correction pour comparaisons multiples. Si ces observations se confirmaient, elles suggéreraient que la combinaison TCC + hypnose pourrait activer des voies complémentaires plutôt que de simplement renforcer un mécanisme commun.
Dans la même logique comparative, une étude plus récente de Çınaroğlu et al. (2025) rapporte que l’hypnothérapie et la TCC génèrent toutes deux des améliorations cliniquement significatives sur l’anxiété et la dépression, sans différence notable entre les deux. Ces résultats, encore à confirmer, soulignent qu’au-delà de l’intégration, l’hypnose peut atteindre une efficacité comparable à celle des protocoles TCC standards.
Enfin, plusieurs revues plus ciblées complètent ce panorama. Milling et al. (2021) confirment l’efficacité de l’hypnose dans la réduction de la douleur somatique, qu’elle soit utilisée seule ou en complément d’autres interventions psychologiques. Valentine et al. (2019) rapportent des effets significatifs de l’hypnose sur l’anxiété comparée à des conditions contrôle – incluant listes d’attente, soins usuels ou interventions psychologiques non spécifiques ; la plus-value spécifique de son intégration à des protocoles TCC reste en revanche peu étudiée. Ce constat est renforcé par un essai contrôlé randomisé récent mené par Fuhr et al. (2023), indiquant que l’hypnothérapie réduit significativement les symptômes d’agoraphobie par rapport à une liste d’attente, confirmant ainsi la faisabilité et l’intérêt de son usage dans certains troubles anxieux spécifiques.
Dans l’ensemble, bien que les données indiquent un potentiel d’action synergique lorsque l’hypnose est combinée à des thérapies structurées comme la TCC, ce potentiel nécessite encore d’être caractérisé et confirmé par des recherches comparatives de plus grande envergure, décrivant précisément les modalités d’intégration.
Note méthodologique : paramètres rarement précisés dans la recherche clinique
La lecture des études et revues met en évidence plusieurs zones d’ombre méthodologiques : le courant d’hypnose8 employé, le protocole d’induction, la profondeur de transe, la réceptivité initiale des participants ou encore la qualité de l’alliance thérapeutique sont rarement décrits ou mesurés de façon systématique. Ces éléments, pourtant susceptibles d’influencer notablement les résultats, sont absents de nombreuses publications. Ce constat rend délicate l’interprétation des essais, en particulier lorsque leurs conclusions soulignent une efficacité limitée ou une absence de preuve. Il invite à considérer que l’impact de l’hypnose ne repose pas uniquement sur un état hypnotique supposé, mais sur la validation de cet état lui-même tout autant que sur l’adaptation de la modalité employée aux objectifs et aux conditions cliniques du moment.
4. Complémentarité TCC + hypnose
4.1 Logique d’intégration
L’intégration de l’hypnose clinique dans un protocole de thérapie comportementale et cognitive ne relève pas d’un simple ajout technique, mais d’une articulation stratégique. Il ne s’agit pas de juxtaposer deux approches en espérant un effet cumulatif, mais de permettre que chacune travaille dans le champ de compétence de l’autre, en s’appuyant sur ses forces propres. La TCC offre des méthodes éprouvées pour restructurer des croyances, modifier des comportements et développer de nouvelles compétences adaptatives. L’hypnose, elle, intervient sur l’état interne qui conditionne la possibilité même de ces apprentissages : disponibilité attentionnelle, sécurité perçue, tolérance émotionnelle, accès aux ressources imaginatives. Cette bascule interne est particulièrement précieuse dans les cas où la TCC seule échoue à franchir certains seuils expérientiels : phobies sévères, TSPT complexes, dépressions avec inhibition imaginale. Dans ces situations, l’hypnose n’a pas vocation à se substituer au protocole, mais à préparer l’espace interne pour que celui-ci puisse s’appliquer de façon plus tolérable et efficace.
Dans ce sens, l’hypnose agit comme un modulateur d’état qui prépare, soutient ou prolonge l’action des méthodes cognitives et comportementaux. Si l’exposition directe s’avère insupportable, l’hypnose peut la précéder : elle abaisse l’hyperactivation physiologique et crée un ancrage sensoriel rassurant, ce qui permet au patient d’y faire face sans recourir à l’évitement. Elle peut aussi intervenir au cœur d’une restructuration cognitive, en facilitant l’accès à des représentations alternatives qui seraient autrement neutralisées par la vigilance défensive. Enfin, elle peut s’inscrire en phase de consolidation, par exemple à travers l’auto-hypnose, pour renforcer les acquis et favoriser leur transfert dans la vie quotidienne.
Ce principe d’intégration repose sur une logique bien documentée dans les travaux de Alladin (2008) sur la Cognitive Hypnotherapy, où l’hypnose soutient la réorganisation cognitive et la mobilisation motivationnelle, ou encore dans le protocole HYP-CT© de Jensen (2011) pour la douleur chronique, qui combine induction hypnotique, travail perceptif et exercices comportementaux spécifiques. Ces exemples montrent que l’hypnose ne modifie pas la destination du traitement, mais optimise les conditions du trajet thérapeutique, en orientant les ressources internes du patient vers l’expérience de changement plutôt que vers les mécanismes de défense ou d’évitement. On pourrait dire que la TCC trace la carte et définit la destination, tandis que l’hypnose prépare la route et rend le voyage possible dans des conditions de sécurité subjectives tolérables permettant de rendre le travail possible. C’est en cela qu’elle constitue un levier d’augmentation : non en apportant un contenu nouveau, mais en modifiant le terrain sur lequel les contenus existants peuvent s’implanter.
4.2. Articulations cliniques par troubles
Si l’hypnose clinique trouve sa place dans le champ des TCC, c’est d’abord parce qu’elle peut s’adapter aux contraintes spécifiques de chaque tableau pathologique, en intervenant là où les procédures standardisées butent sur un verrou expérientiel ou émotionnel. Dans les troubles de stress post-traumatique complexes, par exemple, l’exposition prolongée et la restructuration cognitive peuvent se heurter à deux obstacles majeurs : une désorganisation émotionnelle intense ou une dissociation spontanée qui empêche toute intégration. L’hypnose permet alors d’introduire un espace de travail intermédiaire : le patient peut s’immerger dans certains fragments de l’expérience tout en maintenant une co-conscience protectrice, modulant ainsi la distance émotionnelle et prévenant la sidération corporelle [ Beahrs (1983) ]. Cette approche ne remplace pas l’exposition in vivo, mais la rend possible à un stade ultérieur, dans un environnement interne plus stable. Cette stabilisation préalable ne doit pas être perçue comme un détour inutile mais comme un investissement stratégique : elle augmente la tolérance du sujet à l’exposition et réduit le risque de rupture d’alliance, deux facteurs déterminants de la réussite thérapeutique à moyen terme.
Dans les troubles anxieux sévères, l’hypnose a également démontré son intérêt pour abaisser le niveau d’activation physiologique et accroître la tolérance émotionnelle avant la mise en œuvre des techniques d’exposition. En réduisant le niveau d’hyperactivation et en créant un espace interne sécurisé, l’hypnose rend l’exposition non seulement possible, mais parfois désirable. Le patient peut alors s’y engager avec un sentiment d’auto-efficacité plus fort, ce qui en améliore la valeur thérapeutique. Valentine et al. (2019) rapportent que l’hypnose, comparée à des groupes témoins – qu’il s’agisse de conditions sans intervention spécifique ou d’interventions psychologiques de contrôle – permet une réduction significative des symptômes d’anxiété. La plus-value spécifique de son intégration à des protocoles TCC reste cependant peu documentée.
Dans les phobies sévères ou les évitements massifs, l’enjeu consiste à amorcer un contact psychique sans rupture d’alliance. L’hypnose, en tant que simulation immersive contrôlée, permet un travail imaginal sûr, préparant ainsi la sensibilité du patient sans dépasser le seuil tolérable. Ce travail préparatoire fonctionne comme une préexposition imaginale calibrée : il active suffisamment les circuits émotionnels pour amorcer l’apprentissage, tout en restant dans une zone contrôlée qui préserve la continuité du lien thérapeutique. Une étude de cas illustrant ce principe est celle d’un protocole combinant désensibilisation imaginée en hypnose, auto-hypnose et exposition en réalité virtuelle pour traiter une phobie du vol en avion (aviophobia), retrouvant un effet préparatoire clair avant l’exposition in vivo [ Lupu et al. (2019) ].
En douleur chronique, là où la TCC vise à restructurer les croyances dysfonctionnelles et à encourager l’activation comportementale, l’hypnose offre un accès direct à la dimension perceptive du signal nociceptif. Plutôt que de demander au patient de penser différemment la douleur, elle lui permet de l’éprouver autrement, de la fragmenter, de la déplacer, ou d’en moduler l’intensité. La revue systématique de Jones et al. (2024) montre que cet effet sensoriel contribue à ancrer les stratégies cognitives dans un vécu corporel modifié, réduisant le sentiment de lutte permanente contre la douleur. Dans de nombreux cas, cette reconfiguration perceptive ouvre aussi la voie à des changements comportementaux qui restaient jusque-là inaccessibles : augmentation de l’activité physique, reprise d’activités sociales, diminution de la consommation d’antalgiques.
Dans la dépression résistante, où l’inhibition psychomotrice et l’extinction de l’imaginaire paralysent toute projection, l’hypnose réintroduit une capacité de mise en scène intérieure. Par des états de flottement attentif ou de régression positive, elle ouvre la possibilité d’envisager des situations futures ou alternatives non comme des abstractions mais comme des expériences incarnées. Cette mise en scène intérieure n’est pas un simple « exercice d’imagination » : elle engage des réseaux neuronaux similaires à ceux mobilisés lors d’actions ou d’événements réels, ce qui pourrait renforcer l’impact émotionnel et motivationnel des nouvelles perspectives envisagées. Ramondo et al. (2024) ont montré que l’intégration de ces modules dans un protocole TCC augmentait significativement les taux de rémission à douze mois, en particulier chez les patients initialement non répondeurs.
Enfin, dans les troubles dissociatifs légers, l’hypnose peut restaurer le sentiment d’unité corporelle et soutenir un dialogue interne plus cohérent, là où les seules techniques cognitives peinent à produire cet effet. Cette réunification expérientielle renforce l’alliance thérapeutique et permet d’articuler plus efficacement les différentes phases du protocole TCC.
Ce panorama n’épuise pas les indications possibles, mais il illustre une constante : l’hypnose ne remplace pas la TCC, elle prépare, soutient et amplifie son action en adaptant l’état interne du patient aux exigences de la tâche thérapeutique. Cette complémentarité est d’autant plus pertinente qu’elle s’appuie sur des données cliniques et expérimentales robustes, et qu’elle peut être mise en œuvre sans recourir à un appareillage technologique ou à une pharmacologie spécifique. Cette simplicité logistique rend l’hypnose particulièrement adaptée aux environnements à ressources limitées, aux suivis en ambulatoire, voire aux interventions en urgence, où les moyens matériels ou médicamenteux sont contraints.
4.3. Discussion et perspectives
L’intégration de l’hypnose clinique aux protocoles de thérapie comportementale et cognitive ouvre un champ d’intervention riche, qui reste cependant à structurer de manière plus systématique. Les données empiriques existantes montrent un potentiel significatif, en particulier comme levier d’engagement et de modulation d’état, mais elles se heurtent encore à certaines limites méthodologiques. Par exemple, la majorité des essais contrôlés randomisés disponibles portent sur des échantillons de taille modeste et sur des populations spécifiques, souvent dans des contextes de recherche universitaire. Cette hétérogénéité complique la généralisation des résultats, en particulier pour établir des recommandations standardisées applicables à l’ensemble des pratiques TCC. Il est donc essentiel, pour avancer vers une intégration cohérente, de préciser non seulement les protocoles, mais aussi les contextes cliniques pour lesquels l’hypnose offre une réelle valeur ajoutée. Cette contextualisation éviterait de la présenter comme un outil universel et permettrait de guider les cliniciens dans le choix des modalités d’augmentation les plus pertinentes.
Une revue systématique très récente de White & Khachumova (2025) souligne d’ailleurs que les approches contemporaines de « Cognitive Hypnotherapy » présentent une efficacité comparable à celle de la TCC ou de l’EMDR dans divers troubles mentaux. Si ces résultats venaient à être consolidés par des publications évaluées par les pairs, ils contribueraient à asseoir plus fermement la place de l’hypnose clinique dans le paysage des interventions psychothérapeutiques fondées sur les preuves.
Un autre défi réside dans la diversité des techniques hypnotiques utilisées. Les modules d’hypnose intégrés aux TCC varient fortement d’une étude à l’autre – induction plus ou moins formelle, focalisation sur des métaphores sensorielles, travail sur la mémoire ou sur l’imaginaire futur, degré de co-conscience maintenu. Or, cette variabilité rend difficile l’identification des composantes actives de l’intégration. Il serait donc nécessaire, dans les années à venir, de mieux caractériser ces interventions, de les décrire avec précision dans les publications, et de développer des protocoles reproductibles qui puissent être évalués de façon comparative.
La question des mécanismes reste également ouverte. Certaines études de neuroimagerie, comme celle de Haipt et al. (2024), suggèrent que l’hypnose agit sur des réseaux cérébraux partiellement distincts de ceux mobilisés par la TCC seule, en particulier au niveau du réseau du mode par défaut et des circuits auto-référentiels9. Comprendre comment ces modulations interagissent avec les processus d’extinction, de reconsolidation mnésique et de régulation émotionnelle permettrait de cibler plus finement les situations cliniques où l’hypnose a le plus de valeur ajoutée.
Enfin, toute intégration doit s’appuyer sur un cadre éthique solide. L’usage de l’hypnose en complément des TCC suppose un consentement éclairé du patient, une présentation honnête des bénéfices attendus et des limites, ainsi qu’une attention particulière à la sécurité émotionnelle – notamment lorsque l’on travaille sur des contenus traumatiques ou dissociatifs. La co-conscience, telle que décrite par Beahrs (1983), joue ici un rôle clé pour maintenir une présence réflexive et éviter les effets indésirables d’une immersion non contrôlée.
Ces considérations ne diminuent pas l’intérêt de l’hypnose comme modalité d’augmentation des TCC ; elles en soulignent au contraire la maturité clinique croissante. Pour que cette intégration gagne en légitimité et en diffusion, il faudra non seulement accumuler des preuves empiriques plus robustes, mais aussi promouvoir une culture de précision dans la description des interventions et de prudence dans leur mise en œuvre.
5. Illustration clinique
5.1. Présentation structurée du cas « Sylviane »
Note : ce cas est fictif. Il a toutefois été construit à partir d’éléments cliniques issus de plusieurs histoires de vie réelles, sélectionnés pour leur représentativité et leur récurrence dans la pratique. Toute ressemblance avec des personnes identifiables serait fortuite, le scénario ayant été recomposé afin de préserver la confidentialité absolue.
Identité et contexte socio-familial
Sylviane, femme de 37 ans, travaille à temps partiel dans le secteur éducatif. Elle vit avec son conjoint et leur fils de 8 ans. L’environnement familial est marqué par des tensions constantes et des épisodes de violence conjugale verbale, psychologique et physique, sur fond de forte et régulière consommation d’alcool par le conjoint – cadre supérieur dans le domaine des affaires. Ce climat relationnel instable est émaillé de phases d’apparent apaisement suivies de reprises soudaines des tensions, ce qui entretient un état d’hypervigilance quasi permanent chez Sylviane – et, par extension, chez son fils. La configuration familiale se rapproche d’un système à double contrainte : rester expose au danger, partir semble impensable. L’enfant occupe une place de quasi-parent, prenant en charge émotionnellement sa mère, ce qui traduit une dynamique de parentification inversée.
Antécédents personnels et trajectoire traumatique
Le parcours de Sylviane est jalonné d’événements traumatiques précoces et répétés : anorexie sévère (IMC < 12,7) à 13 ans – début de l’adolescence, période de construction du rapport au corps et à soi – dans un contexte de négligence émotionnelle et de surcharge de responsabilités familiales, deuil d’une amie intime avec culpabilité persistante, échec scolaire, plusieurs relations marquées par l’emprise psychologique, et violences conjugales actuelles. Ces expériences sédimentent un sentiment d’impuissance acquis, renforcé par la multiplication des cycles de domination, par une dépendance financière notable et par la difficulté à accéder à un soutien social fiable. Une tentative de suicide avérée10 a été rapportée par IMV11 aux benzodiazépines à 34 ans – qualifiée d’ »appel à l’aide » dans le dossier médical – ayant conduit à une courte hospitalisation en unité psychiatrique et mise en place d’un suivi médicopsychologique au long cours, toujours actif.
Diagnostic clinique
L’évaluation psychiatrique et psychologique réalisée par des professionnels, complétée par des outils standardisés dont le CAPS-5, a conduit à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe (TSPT-C), avec épisodes dissociatifs secondaires, dans un fonctionnement borderline post-traumatique12. Le tableau inclut : déréalisation, narrations fragmentées, culpabilité obsédante, effondrements affectifs soudains, altération majeure de l’image de soi, honte corporelle, comportements d’auto-apaisement dissociatifs, et ambivalence relationnelle marquée entre fusion et auto-effacement. Un traumatisme sexuel intrafamilial ancien, non verbalisé, est fortement suspecté. L’absence de verbalisation explicite ne signifie pas absence d’impact : plusieurs indices cliniques – réactions corporelles à certains stimuli, évitements implicites, tonalité émotionnelle lors d’évocations périphériques – orientent vers un vécu traumatique précoce non intégré.
État initial à l’entrée en suivi
Lors des premières séances, Sylviane présente un discours cohérent sur le plan formel, mais peu connecté sur le plan émotionnel. L’alliance thérapeutique est stable mais sans profondeur : la patiente verbalise ses difficultés avec une apparente bonne volonté, tout en restant coupée de son vécu corporel et affectif. Ce décalage constant entre le contenu verbal et l’expérience vécue constitue un signe classique de dissociation secondaire active : le discours est « propre », mais il flotte au-dessus d’un vécu émotionnel qui reste inaccessible dans le cadre conversationnel classique. Les premières interventions issues des TCC (psychoéducation sur le trauma, identification des schémas, journalisation des pensées automatiques) montrent rapidement leurs limites : absence d’engagement émotionnel, rationalisation défensive, et apparition de flashs sensoriels incontrôlés lors des tentatives d’exposition.
Enjeux thérapeutiques identifiés
Le tableau clinique observé s’explique par plusieurs facteurs :
- réactions émotionnelles intenses et difficilement modulables lors de l’évocation d’éléments liés à l’histoire de vie ;
- tendance dissociative qui court-circuite l’intégration des contenus abordés ;
- image de soi profondément négative, renforçant l’évitement des expériences correctrices ;
- déficit de ressources attentionnelles et corporelles pour soutenir le travail expérientiel.
Ces constats ont conduit, après discussion entre la patiente et son psychologue, à envisager un ajustement du protocole TCC afin de lui permettre d’accéder progressivement à un état interne compatible avec l’exploration émotionnelle et cognitive, sans risque de désorganisation. L’hypnose clinique a été retenue comme modalité complémentaire, avec l’accord de la patiente et sur recommandation professionnelle, non pour remplacer les techniques TCC, mais pour en faciliter l’accès et en potentialiser les effets.
Note sur l’absence d’EMDR dans le dispositif
Bien que l’EMDR13 soit aujourd’hui l’un des protocoles de référence dans le traitement du TSPT, y compris dans ses formes complexes, il n’a pas été intégré à ce stade du suivi. La présence d’une dissociation secondaire marquée, d’une instabilité émotionnelle importante et d’une fenêtre de tolérance réduite exposait à un risque élevé de débordement ou de rupture d’alliance. L’option retenue a donc été de différer toute approche à forte charge émotionnelle bilatérale, en privilégiant un travail préparatoire centré sur la stabilisation, la réintégration corporelle et l’élargissement progressif de la capacité de régulation. Cette phase conditionne la réussite d’éventuelles interventions ultérieures orientées directement sur les contenus traumatiques.
5.2. Intégration de l’hypnose
L’introduction de l’hypnose dans le suivi de Sylviane a été pensée comme une modalité de soutien, insérée à des moments stratégiques du protocole TCC. Les premières séances ont été consacrées à installer un cadre de sécurité interne et à évaluer la tolérance de la patiente à des exercices attentionnels et imaginatifs. Cette phase préparatoire a privilégié des inductions douces et permissives, visant non pas la profondeur hypnotique, mais la consolidation d’un état de co-présence : la patiente restait consciente du contexte tout en s’autorisant à se plonger dans une expérience interne contrôlée. Ce choix méthodologique est central, puisque dans les cas marqués par une dissociation secondaire, viser d’emblée un état hypnotique profond peut accentuer la déconnexion plutôt que favoriser l’intégration. La priorité était donc de cultiver une conscience double – ancrée dans le présent tout en s’autorisant l’exploration intérieure.
Un premier objectif a consisté à créer un « lieu-refuge » sensoriel, élaboré de manière interactive, puis enrichi au fil des séances. Ce lieu, ancré par des repères kinesthésiques simples et un mot de rappel convenu, est devenu un point d’appui constant pour moduler l’activation émotionnelle. L’intention n’était pas d’offrir une échappatoire ou une modalité d’évitement supplémentaire, mais de disposer d’un espace interne de prise de recul utilisable en séance si l’activation devenait excessive. Ce type d’ancrage est non seulement utile dans le cadre thérapeutique, mais aussi transférable dans la vie quotidienne, offrant à la patiente un outil d’auto-régulation mobilisable face aux déclencheurs contextuels. Sa mise en place a progressivement permis à Sylviane d’explorer, par touches brèves, des souvenirs ou sensations habituellement évités, sans franchir le seuil de désorganisation.
Dans un second temps, des scénarios métaphoriques ont été introduits – forêt protectrice, pièce de dépôt, chemin ouvert – pour travailler la mise à distance active des images intrusives et préparer l’accès à des contenus plus sensibles. Cette étape intermédiaire correspond à ce que certains auteurs décrivent comme une « exposition symbolique » – ou « exposition en imagination » : elle active les réseaux émotionnels et mnésiques de manière contrôlée, ouvrant la voie à un traitement plus direct des contenus sans franchir prématurément le seuil de tolérance. La construction de ces métaphores a toujours été faite en dialogue, en veillant à préserver l’autonomie interprétative de la patiente.
À mesure que la capacité de régulation augmentait, des séquences plus ciblées sur les situations traumatiques ont été intégrées, non pas dans une logique d’exposition directe, mais comme des « visites contrôlées » de fragments mnésiques. Chaque immersion était suivie d’un retour au lieu-refuge et d’un temps de verbalisation, ce qui facilitait la liaison entre expérience hypnotique et travail cognitif. Cette articulation a permis de réintroduire progressivement des techniques TCC jusque-là inefficaces, comme la restructuration des croyances dysfonctionnelles ou la mise en lien entre émotions, pensées et comportements. Ici, l’hypnose a joué un rôle de catalyseur : en modifiant l’état interne, elle a permis que les outils cognitifs soient vécus, et non simplement compris. Les nouvelles croyances n’étaient pas seulement formulées, elles étaient déjà susceptibles d’être incarnées dans un vécu sensoriel et émotionnel.
L’ensemble du dispositif a été pensé comme un cycle : sécurisation, exploration modulée, retour à la sécurité, intégration cognitive. Ce rythme a permis à Sylviane de passer d’une position de retrait défensif fermé au changement à une participation active au processus thérapeutique, tout en maintenant la stabilité émotionnelle nécessaire pour éviter les ruptures d’alliance ou les réactions dissociatives prolongées.
5.3. Résultats et suivi
Au fil des séances, plusieurs évolutions significatives ont été observées. Sur le plan émotionnel, les réactions d’hyperactivation initialement fréquentes lors de l’évocation d’éléments traumatiques se sont atténuées, laissant place à une modulation plus progressive des affects. Ce changement qualitatif dans la régulation émotionnelle a eu un effet direct sur la capacité de Sylviane à rester engagée dans les tâches thérapeutiques, même lorsqu’elles impliquaient une activation affective notable. Il ne s’agissait plus d’éviter ou de bloquer l’émotion, mais de la traverser avec un certain degré de contrôle. Sylviane a pu identifier et nommer ses émotions avec une plus grande précision, ce qui a facilité leur régulation et ouvert un espace pour un travail cognitif plus efficace.
L’ancrage hypnotique mis en place dans les premières séances est devenu un outil que Sylviane mobilisait spontanément, y compris en dehors du cadre thérapeutique. Cette internalisation de la stratégie – le recours à l’ancrage ne dépendant plus de la présence du thérapeute – a contribué à diminuer la fréquence des épisodes dissociatifs secondaires et à renforcer son sentiment de contrôle sur ses états internes.
L’articulation entre l’hypnose et les techniques TCC a également permis une reprise progressive des interventions qui, auparavant, restaient inefficaces. La restructuration cognitive a pu s’appuyer sur des expériences vécues en hypnose, rendant les nouvelles croyances plus incarnées et moins purement conceptuelles. Ce passage du conceptuel à l’expérientiel est central dans l’efficacité de la TCC augmentée : il consolide l’apprentissage en l’inscrivant dans un vécu subjectif, ce qui augmente les chances de transfert dans la vie quotidienne. Les exercices d’exposition graduée, introduits tardivement dans le processus, ont été mieux tolérés, sans rupture d’alliance ni sidération, ni réactance face aux tâches proposées.
Sur le plan comportemental, Sylviane a amorcé des changements concrets : reprise de certaines activités sociales limitées, élaboration d’un « plan de sécurité » pour elle et son fils, et début de démarches vers des structures spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences. Bien que la situation conjugale reste inchangée à ce stade, la patiente exprime une intention plus affirmée de se protéger et de protéger son enfant. Ces micro-changements comportementaux – parfois invisibles hors du suivi – témoignent d’un déplacement du locus de contrôle : la patiente ne se pense plus uniquement comme objet des événements, mais comme actrice de certaines décisions clés, ce qui renforce son sentiment d’auto-efficacité et d’empowerment14.
Après plusieurs mois, la trajectoire thérapeutique ne peut être qualifiée de résolue, mais l’évolution est marquée par une diminution de la détresse subjective, un renforcement des capacités de régulation émotionnelle et une implication accrue dans le processus de soin. L’hypnose n’a pas remplacé les techniques TCC, mais a contribué à en rendre l’application possible et à en potentialiser les effets dans un contexte initialement peu propice à l’engagement thérapeutique.
Bien qu’il s’agisse d’un cas unique, sans valeur de preuve généralisable, il illustre de façon concrète la manière dont l’hypnose peut soutenir un protocole TCC dans un contexte complexe. Les évolutions observées chez Sylviane – renforcement de l’alliance, accroissement de l’engagement et reprise progressive d’outils TCC jusque-là inefficaces – rejoignent d’ailleurs certains constats rapportés dans la littérature, notamment l’association positive entre hypnose, attentes thérapeutiques et évolution symptomatique décrite par Ramondo et al. (2024).
6. Discussion
6.1. Atouts spécifiques de l’hypnose comme modalité d’augmentation
L’intégration de l’hypnose dans les protocoles TCC ne se résume pas à l’ajout d’une technique supplémentaire : elle introduit une dimension expérientielle qui modifie la manière dont les interventions cognitives et comportementales peuvent être vécues et assimilées par le patient. Contrairement aux approches exclusivement verbales ou analytiques, l’hypnose clinique agit sur la configuration même de l’état interne – attention, perception, mémoire, activation physiologique – dans lequel se déroule le travail thérapeutique.
L’un de ses principaux atouts réside dans la capacité à moduler finement l’activation émotionnelle. En offrant un accès contrôlé à des contenus sensibles tout en préservant une co-conscience protectrice Beahrs (1983), elle permet de travailler sur des représentations traumatiques ou anxiogènes sans franchir le seuil de désorganisation. Cette possibilité de travailler « au bord » de l’activation optimale, sans basculer dans l’excès ou l’insuffisance, rejoint la notion de « zone proximale d’intervention émotionnelle » : un espace où le système nerveux reste assez mobilisé pour apprendre, mais pas au point d’être submergé. Cette régulation en temps réel constitue un avantage majeur dans les situations où les méthodes TCC classiques se heurtent à des réactions de fuite ou de sidération.
L’hypnose facilite également l’incarnation des changements cognitifs. Les nouvelles interprétations, restructurations ou croyances élaborées en séance ne restent pas à l’état de formulations verbales : elles sont vécues dans un contexte imaginal et sensoriel qui en renforce la mémorisation et l’intégration. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi, dans certains suivis, les changements amorcés en hypnose semblent se maintenir plus durablement, puisqu’ils ne sont pas seulement compris intellectuellement, mais intégrés comme des schémas sensoriels et émotionnels nouveaux. Les travaux de neuroimagerie de Haipt et al. (2024) suggèrent que cette dimension expérientielle engage des réseaux cérébraux liés à l’intégration intéroceptive et à la modulation auto-référentielle, ce qui pourrait contribuer à expliquer une meilleure consolidation des acquis thérapeutiques.
Un autre avantage est la souplesse contextuelle. L’hypnose peut être appliquée dans des environnements très divers, sans matériel coûteux ni recours à des substances pharmacologiques, ce qui la rend adaptable aux contraintes de la pratique clinique quotidienne, y compris en contexte de soins primaires ou dans des structures à ressources limitées. Cette adaptabilité ne concerne pas seulement le lieu ou le matériel : elle s’étend aussi à la culture professionnelle et au style thérapeutique du praticien, qui peut intégrer l’hypnose sans renoncer à ses repères méthodologiques principaux.
Enfin, l’hypnose encourage une implication active du patient. En coconstruisant les images, métaphores et scénarios, le sujet devient acteur de l’expérience thérapeutique, ce qui peut renforcer l’alliance et accroître la motivation à poursuivre le travail. Cette dimension collaborative se distingue d’outils plus « externes » ou passifs, où le patient se contente de recevoir un stimulus ou une information.
6.2. L’hypnothérapie : une approche complémentaire pour travailler en profondeur
Si l’hypnose clinique offre des leviers d’augmentation prometteurs dans le cadre des TCC, son utilisation exige un cadre rigoureux. L’une des premières limites tient à la variabilité interindividuelle des réponses hypnotiques. Bien que la suggestibilité ne soit pas un facteur fixe et immuable, elle peut conditionner la facilité avec laquelle certaines techniques sont mises en œuvre. Cette variabilité impose une évaluation préalable – formelle ou informelle – et une adaptation fine des interventions, afin d’éviter les effets déceptifs ou la démobilisation du patient. Cette adaptation implique aussi de savoir renoncer temporairement à l’hypnose si l’état clinique ou l’alliance ne sont pas propices, plutôt que de forcer son intégration au risque de fragiliser le processus thérapeutique.
La diversité des approches hypnotiques constitue un point de vigilance majeur. Les modalités d’induction, la place donnée à la co-conscience, la nature des suggestions, la durée des séquences et leur articulation avec les outils TCC varient fortement d’un praticien à l’autre. Cette hétérogénéité complique la standardisation des protocoles et rend difficile l’évaluation comparative de leur efficacité. La protocolisation stricte n’est pas toujours possible, ni même souhaitable, chaque situation clinique présentant des spécificités qui appellent une adaptation fine. Dans la pratique, cela oriente vers des approches personnalisées, combinant différents outils en fonction du profil, des besoins et des objectifs du patient, tout autant que du contexte momentané : ce qui est pertinent ou tolérable à une séance donnée ne l’est pas nécessairement à une autre.
À cette variabilité inter-praticiens s’ajoute une variabilité interindividuelle marquée. Tous les patients ne réagissent pas à l’hypnose de la même manière ni au même rythme ; leur suggestibilité, leur tolérance émotionnelle ou leur capacité de focalisation diffèrent, et le processus hypnotique doit être ajusté en temps réel. Cette double variabilité – entre praticiens et entre patients – explique pourquoi les essais cliniques peinent à capturer toute la richesse et la plasticité du travail hypnotique. Les ajustements dynamiques sont rarement décrits ou mesurés, ce qui affaiblit la comparabilité des études. C’est pourquoi une description précise des techniques employées demeure indispensable, non seulement pour garantir la reproductibilité scientifique et la transparence, mais aussi, en clinique, pour maintenir la cohérence du protocole et analyser ses effets au fil du suivi, notamment dans les équipes pluridisciplinaires.
Sur le plan clinique, l’hypnose n’est pas dénuée de risques spécifiques. Chez les patients présentant des troubles dissociatifs sévères, des psychoses aiguës ou une instabilité émotionnelle extrême, certaines techniques peuvent exacerber les symptômes ou déclencher des réactions imprévisibles. La gestion de ces risques passe par un dépistage préalable des contre-indications, une adaptation du degré d’immersion et le maintien, lorsque nécessaire, d’une co-conscience active. Les précautions sont particulièrement importantes dans le traitement du trauma, où un usage non calibré pourrait conduire à un débordement émotionnel ou à une reviviscence non intégrée. Pour cette raison, certains praticiens utilisent systématiquement un « sas de sortie » à la fin des séances orientées sur des contenus sensibles, afin de réinstaller un état de stabilité et de réduire le risque d’effets post-séance indésirables. C’est pourquoi l’évaluation initiale – suggestibilité, tolérance émotionnelle, capacité de régulation – doit être intégrée comme étape formelle du protocole, au même titre que l’anamnèse ou la définition des objectifs thérapeutiques.
Enfin, l’hypnose exige une formation spécifique et continue. Son intégration aux TCC ne peut se réduire à l’apprentissage de scripts ou de techniques isolées : elle suppose une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques et neurocognitifs sous-jacents, ainsi qu’une capacité à ajuster en temps réel le cadre et le contenu de la séance en fonction des réactions du patient. L’absence de cette compétence augmente le risque d’erreurs techniques, de ruptures d’alliance et de perte d’efficacité thérapeutique. L’exigence de compétence technique inclut aussi la capacité à reconnaître ses propres limites et à solliciter une supervision en cas de situations cliniques inhabituelles ou complexes. Cette exigence de compétence ne doit pas être perçue comme une barrière dissuasive, mais comme une garantie de sécurité et d’efficacité. Une formation solide, continue et supervisée protège non seulement le patient, mais aussi le praticien, en limitant les risques de ruptures d’alliance ou de mésusage technique.
Si l’exigence de formation, de supervision et d’éthique est incontestable pour garantir la qualité des pratiques et prévenir les dérives charlatanesques, elle ne doit pas servir de prétexte à réduire l’usage de l’hypnose thérapeutique au seul champ des professions médicales ou paramédicales déjà établies. Le fait d’avoir suivi un cursus plus ou moins bref en « hypnose médicale » – souvent limité à une quarantaine d’heures – ne confère pas ipso facto – et de très loin – la maîtrise des compétences nécessaires à un usage approfondi et sécurisé de l’outil. La compétence hypnotique s’acquiert par une formation longue, structurée, centrée sur l’articulation entre processus psychologiques, neuroscientifiques et techniques relationnelles, indépendamment de l’appartenance à une profession de santé ou réglementée existante. À ce titre, la création d’une profession de santé spécifique d’ »hypnothérapeute » – dotée de standards clairs en matière de formation initiale, de supervision continue et de code éthique – offrirait un cadre plus cohérent et protecteur, à la fois pour les praticiens et pour les patients.
En résumé, l’hypnose peut constituer un puissant levier d’augmentation des TCC, mais seulement si elle est employée dans un cadre maîtrisé, avec une vigilance constante quant aux indications, aux techniques utilisées et à la sécurité émotionnelle du patient.
6.3. Perspectives de recherche
Si l’hypnose clinique a déjà démontré son potentiel comme modalité d’augmentation des TCC, les données disponibles restent encore trop fragmentaires pour permettre des recommandations pleinement standardisées. Plusieurs axes de recherche apparaissent prioritaires.
Le premier concerne la standardisation des protocoles intégrés. Les études actuelles utilisent des approches hétérogènes en termes d’induction, de durée, de contenu métaphorique et de degré de co-conscience maintenu. Cette variabilité complique l’identification des composantes actives et des conditions optimales d’efficacité. Des essais comparatifs, décrivant précisément chaque composant et son séquencement, permettraient de dégager des formats reproductibles et évaluables.
Le second axe est celui des études mécanistiques. Les données de neuroimagerie, comme celles de Haipt et al. (2024), suggèrent que l’hypnose agit sur des circuits cérébraux distincts de ceux mobilisés par la TCC seule. Comprendre comment ces modulations influencent la reconsolidation mnésique, la régulation émotionnelle et l’apprentissage comportemental pourrait permettre de mieux cibler les indications.
Un troisième domaine de recherche concerne la mesure des effets à long terme. La plupart des études disponibles évaluent les résultats à court ou moyen terme, mais peu documentent la persistance des bénéfices au-delà d’un an, ni l’impact sur la prévention des rechutes. Des suivis longitudinaux et des études de cohortes offriraient une vision plus complète de la durabilité des effets.
Enfin, un enjeu transversal réside dans l’intégration interdisciplinaire. Des recherches associant psychologues, psychiatres, hypnothérapeutes formés et chercheurs en neurosciences permettraient de croiser les approches et de dépasser les cloisonnements institutionnels. Cette collaboration pourrait contribuer à un cadre de formation et de pratique commun, garantissant la qualité des interventions tout en respectant la diversité des parcours professionnels. Elle favoriserait aussi l’enrichissement des pratiques individuelles et, au-delà des compétences propres à chacun, une meilleure orientation des patients vers les spécialistes les plus adaptés à leur prise en charge..
En sus de ces axes, deux domaines mériteraient également une attention accrue. Le premier concerne la mise en œuvre en conditions réelles : si la majorité des données provient d’essais contrôlés ou de contextes universitaires, nous manquons encore d’études naturalistes ou pragmatiques documentant la manière dont l’intégration TCC + hypnose pourrait se déployer en pratique courante, avec ses ajustements, ses contraintes et ses leviers spécifiques. Le second touche à la formation et au transfert des compétences : identifier les savoir-faire indispensables, évaluer l’efficacité des formats pédagogiques et comprendre comment ces compétences se transmettent dans des équipes pluridisciplinaires sont des enjeux tout aussi déterminants que la validation de l’outil lui-même.
En combinant rigueur méthodologique, précision descriptive et ouverture interdisciplinaire, la recherche future pourrait non seulement consolider la place de l’hypnose dans les TCC, mais aussi affiner la compréhension de ses mécanismes et élargir ses applications cliniques de manière raisonnée et complémentaire.
Au-delà de ces constats généraux, certaines pistes précises mériteraient d’être explorées pour structurer l’avenir de ce champ. Il serait, par exemple, utile de conduire des essais contrôlés randomisés de plus grande ampleur, incluant non seulement des mesures symptomatiques mais aussi des évaluations systématiques de l’alliance thérapeutique, de la suggestibilité hypnotique et de la tolérance émotionnelle des patients. De même, la description fine et transparente des protocoles d’induction et des modalités d’intégration à la TCC devrait devenir une exigence de publication, afin de faciliter la reproductibilité et la comparaison des résultats. Enfin, des études coût-bénéfice permettraient d’évaluer si l’ajout de l’hypnose optimise réellement l’efficience des prises en charge, dimension aujourd’hui absente de la littérature.
7. Conclusion
L’intégration de l’hypnose clinique aux thérapies comportementales et cognitives n’est ni un artifice, ni une simple juxtaposition de techniques. Elle représente une opportunité d’agir simultanément sur le contenu thérapeutique et sur l’état interne qui en conditionne l’assimilation. En modulant l’attention, la perception, la mémoire et l’activation émotionnelle, l’hypnose offre un environnement psychophysiologique favorable à la mise en œuvre et à la consolidation des acquis TCC, en particulier dans les contextes cliniques où l’engagement est entravé ou la fenêtre de tolérance étroite. Ce faisant, elle contribue aussi à restaurer une flexibilité mentale, entendue comme la capacité à s’extraire de schémas figés pour explorer des alternatives cognitives et émotionnelles. Or cette flexibilité, souvent compromise dans les troubles anxieux, dépressifs ou post-traumatiques, constitue l’un des déterminants centraux de l’efficacité thérapeutique.
Les données empiriques, bien que perfectibles, convergent pour indiquer une valeur ajoutée clinique tangible dans plusieurs études, notamment dans la gestion des troubles anxieux sévères, des syndromes post-traumatiques complexes, de la douleur chronique ou des états dépressifs résistants. Cette plus-value reste toutefois variable selon les contextes et doit encore être confirmée par des recherches de plus grande envergure.
Par ailleurs, réduire l’hypnose thérapeutique à un champ réservé exclusivement aux professions médicales ou paramédicales actuelles, parfois sur la base de formations minimales, ne répond ni aux besoins cliniques, ni aux exigences de compétence que requiert cet outil. L’enjeu n’est pas d’opposer les métiers existants et les praticiens formés à l’hypnose, mais de travailler ensemble à élever les standards de formation, de supervision et d’éthique. Reconnaître l’hypnose clinique comme une discipline à part entière, avec un statut professionnel clair et des standards exigeants, serait une avancée pour la qualité des soins et la sécurité des patients.
En définitive, considérer l’hypnose comme une modalité d’augmentation des TCC, ce n’est pas seulement enrichir l’arsenal technique, c’est aussi accepter que l’efficacité thérapeutique repose sur l’articulation fine entre méthodes éprouvées et état interne du patient. Cette articulation ne se décrète pas : elle se construit séance après séance, dans un cadre sécurisant, avec des ajustements constants, et en respectant la temporalité propre de la personne.
Il est temps que la recherche, la formation et les pratiques de terrain convergent pour dépasser les clivages institutionnels et théoriques, afin d’explorer pleinement le potentiel de cette modalité d’augmentation. L’hypnose clinique, lorsqu’elle est employée avec discernement et intégrée dans un protocole structuré, peut devenir non pas une alternative aux TCC, mais un vecteur qui en amplifie la portée, au plus près des besoins et des ressources de chaque patient.
8. Sur le cadre et la portée de cet article
Le présent article s’inscrit dans une perspective de réflexion clinique et critique. Il ne constitue en aucun cas une recommandation médicale, ni un avis thérapeutique individualisé.
Je – Stéphan GAZANHES – ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, ni psychothérapeute, ni, plus généralement, praticien d’une profession de santé réglementée. Je suis un hypnothérapeute indépendant et n’interviens donc pas dans un cadre médicalisé.
Bien que n’étant pas non plus chercheur au sens institutionnel du terme, j’ai choisi, depuis de nombreuses années, de m’engager de manière rigoureuse dans l’exploration des enjeux cliniques, psychologiques et relationnels liés à la pratique de l’hypnose thérapeutique. Cette démarche s’appuie sur une formation continue, une fréquentation exigeante des sources scientifiques disponibles, et une pratique éthique supervisée – notamment par une docteure en neurosciences et psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, neurobiologie, psychopathologie et psychopharmacologie – ainsi qu’une volonté constante d’articuler réflexion, clinique et responsabilité.
Je ne prétends nullement rivaliser avec l’expertise académique ou médicale, mais souhaite contribuer à un dialogue transdisciplinaire lucide, respectueux et ouvert.
Les termes employés – tels que « hypnose clinique » ou « trouble de stress post-traumatique complexe » – renvoient ici à des constructions théoriques et à des catégories institutionnelles utilisées à des fins d’analyse, et non à des diagnostics posés de ma part.
L’accompagnement en hypnose décrit à la section 5 relève d’un cadre non médical, orienté vers l’expérience subjective, la symbolisation et l’alliance relationnelle. Il s’inscrit dans une logique complémentaire, qui suppose – lorsque nécessaire – une articulation explicite avec le suivi médical ou psychothérapeutique du patient.
L’étude de cas présentée est fictive, construite à partir de situations réelles croisées, dans un souci de représentativité clinique et de confidentialité absolue.
9. Bibliographie
Alladin, A. (2008). Cognitive Hypnotherapy : An Integrated Approach to the Treatment of Emotional Disorders (1re éd.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470773239
Bandura, A. (1977). Self-efficacy : Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191‑215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
Bandura, A. (1997). Self-efficacy : The exercise of control. W.H. Freeman.
Beahrs, J. O. (1983). Co-Consciousness : A Common Denominator in Hypnosis, Multiple Personality, and Normalcy. American Journal of Clinical Hypnosis, 26(2), 100‑113. https://doi.org/10.1080/00029157.1983.10404150
Çınaroğlu, M., Yılmazer, E., Odabaşı, C., Ülker, S. V., & Hızlı Sayar, G. (2025). Comparing Cognitive Behavioral Therapy and Ericksonian Hypnotherapy for subclinical depression and anxiety : A randomized controlled trial. American Journal of Clinical Hypnosis, 67(3), 288‑304. https://doi.org/10.1080/00029157.2025.2460581
Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy : An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10‑23. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006
Fuhr, K., Bender, A., Wiegand, A., Janouch, P., Drujan, M., Cyrny, B., Schweizer, C., Kreifelts, B., Nieratschker, V., & Batra, A. (2023). Hypnotherapy for agoraphobia—Feasibility and efficacy investigated in a pilot study. Frontiers in Psychology, 14, 1213792. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1213792
Haipt, A., Rosenbaum, D., Fuhr, K., Batra, A., & Ehlis, A.-C. (2024). Differential effects of hypnotherapy and cognitive behavioral therapy on the default mode network of depressed patients. Frontiers in Psychology, 15, 1401946. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1401946
Jensen, M. P. (2011). Hypnosis for chronic pain management : Therapist guide. Oxford University Press.
Jensen, M. P., & Patterson, D. R. (2014). Hypnotic approaches for chronic pain management : Clinical implications of recent research findings. American Psychologist, 69(2), 167‑177. https://doi.org/10.1037/a0035644
Jones, H. G., Rizzo, R. R. N., Pulling, B. W., Braithwaite, F. A., Grant, A. R., McAuley, J. H., Jensen, M. P., Moseley, G. L., Rees, A., & Stanton, T. R. (2024). Adjunctive use of hypnosis for clinical pain : A systematic review and meta-analysis. PAIN Reports, 9(5), e1185. https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000001185
Landry, M., Lifshitz, M., & Raz, A. (2017). Brain correlates of hypnosis : A systematic review and meta-analytic exploration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 81, 75‑98. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.02.020
Lupu, V., Department of Psychiatry & Child & Adolescent Psychiatry, I. Haţieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania », Lupu, V., Matu, S., « Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania », Lupu, R., & I. Hațieganu School, Cluj-Napoca, Romania. (2019). Cognitive-behavioral hypnotherapy augmented with virtual reality exposure in flight phobia : A case study. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 19(1), 49‑58. https://doi.org/10.24193/jebp.2019.1.3
Milling, L. S., Valentine, K. E., LoStimolo, L. M., Nett, A. M., & McCarley, H. S. (2021). Hypnosis and the Alleviation of Clinical Pain : A Comprehensive Meta-Analysis. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 69(3), 297‑322. https://doi.org/10.1080/00207144.2021.1920330
Oakley, D. A., & Halligan, P. W. (2013). Hypnotic suggestion : Opportunities for cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(8), 565‑576. https://doi.org/10.1038/nrn3538
Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. American Journal of Community Psychology, 23(5), 569‑579. https://doi.org/10.1007/BF02506982
Ramondo, N., Pestell, C. F., Byrne, S. M., & Gignac, G. E. (2024). Cognitive Behavioral Therapy and Hypnosis in the Treatment of Major Depressive Disorder : A Randomized Control Trial. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 72(3), 229‑253. https://doi.org/10.1080/00207144.2024.2354722
Rosendahl, J., Alldredge, C. T., & Haddenhorst, A. (2024). Meta-analytic evidence on the efficacy of hypnosis for mental and somatic health issues : A 20-year perspective. Frontiers in Psychology, 14, 1330238. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1330238
Skjerdingstad, N. (2024). An inhibitory learning-based turn in exposure therapy. Nature Reviews Psychology, 3(11), 726‑726. https://doi.org/10.1038/s44159-024-00370-5
Terhune, D. B., Cleeremans, A., Raz, A., & Lynn, S. J. (2017). Hypnosis and top-down regulation of consciousness. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 81, 59‑74. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.02.002
Valentine, K. E., Milling, L. S., Clark, L. J., & Moriarty, C. L. (2019). The Efficacy of Hypnosis as a Treatment for Anxiety : A Meta-Analysis. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 67(3), 336‑363. https://doi.org/10.1080/00207144.2019.1613863
White, D., & Khachumova, A. (2025). A Systematic Review of the Effectiveness of Modern Cognitive Hypnotherapy in Mental Disorders (2018-2023). 478383 Bytes. https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.29497991.V1
Wolf, T. G., Faerber, K. A., Rummel, C., Halsband, U., & Campus, G. (2022). Functional Changes in Brain Activity Using Hypnosis : A Systematic Review. Brain Sciences, 12(1), 108. https://doi.org/10.3390/brainsci12010108
Fin de l’article : Hypnose & TSPT : Comprendre et Apaiser | Stéphan Gazanhes (stress post-traumatique hypnose)

- Du 11 au 13 décembre 2025, à la Maison de la Chimie (Paris). ↩︎
- Terme utilisé ici dans son acception courante pour désigner les personnes accompagnées. Bien que n’étant pas psychologue, médecin ou autre professionnel de santé réglementé, je l’emploie dans cet article pour sa clarté, sans implication d’un statut médical. ↩︎
- Dans le présent article, j’emploie le terme « hypnose clinique » pour désigner une hypnose pratiquée dans une visée thérapeutique rigoureuse et exigeante, fondée sur l’expérience subjective, l’écoute active et le respect du cadre relationnel. Cela ne constitue pas nécessairement un acte médical, et son usage ici ne présume pas d’un statut de professionnel de santé ni d’appartenance à une profession réglementée. Se référer au chapitre 8 pour plus d’informations sur le cadre et la portée de cet article. ↩︎
- Dans un cadre hypnotique, désigne la capacité du sujet à maintenir simultanément deux niveaux de traitement de l’expérience – l’un immergé dans le scénario ou l’état induit, l’autre métacognitif, observant et contextualisant ce qui se déroule. Cette configuration implique une activité parallèle des réseaux attentionnels impliqués dans la focalisation interne et des réseaux de contrôle exécutif maintenant la référence au contexte. Elle permet d’accéder à des contenus émotionnels ou mnésiques tout en conservant un sentiment d’identité et de sécurité, ce qui la distingue d’états dissociatifs pathologiques. ↩︎
- Ces trois réseaux cérébraux jouent un rôle conjoint dans la régulation de l’expérience consciente. Le DMN agit comme un « circuit narratif » tourné vers les pensées internes et la rumination ; le CEN fonctionne comme un « logiciel de contrôle » pour la planification et la résolution de tâches ; le SN, quant à lui, agit comme un « variateur » qui arbitre en permanence l’orientation de l’attention entre monde interne et externe (notamment via l’insula et le cortex cingulaire antérieur). ↩︎
- Les « boucles auto-référentielles » désignent l’activité récurrente du cerveau centrée sur soi (auto-jugement, rumination, ressassement). On peut les voir comme un circuit de rétroaction où l’esprit tourne en rond sur ses propres contenus, souvent de façon stérile ou anxiogène. Ces boucles sont fortement associées au réseau du mode par défaut (DMN). ↩︎
- À l’inverse, certaines méthodes d’ »exposition cathartique« »« (ou flooding), qui visent à faire revivre l’émotion dans toute son intensité dès les premières séances, se sont révélées problématiques : débordement émotionnel, rupture d’alliance, dissociation secondaire, voire aggravation symptomatique. Ces effets délétères ont conduit à un consensus : l’exposition ne gagne pas en efficacité en intensité brute, mais en calibrage. Les modèles contemporains s’appuient ainsi sur la logique d’inhibitory learning, où l’émotion doit être activée dans une « fenêtre de tolérance » – suffisamment forte pour produire un apprentissage, mais pas au point de submerger le patient [ Craske et al. (2014), Skjerdingstad (2024) ]. ↩︎
- On appelle courant d’hypnose un ensemble cohérent de pratiques et de références théoriques qui structurent une manière particulière de concevoir et de mettre en œuvre l’hypnose. Chaque courant se distingue par ses techniques privilégiées (plus ou moins directives, symboliques, expérientielles…), par son rapport à la conscience et à la suggestion, et par ses fondements théoriques (psychodynamiques, comportementaux, humanistes, phénoménologiques, etc.). Parmi les principaux courants d’hypnose, on retrouve l’hypnose classique, l’hypnose ericksonienne, l’hypnose elmanienne, la nouvelle hypnose, l’hypnose humaniste ou encore l’hypnose phénoménologique. ↩︎
- Les circuits auto-référentiels désignent l’activité cérébrale tournée vers soi, impliquant surtout le réseau du mode par défaut (DMN). Ils correspondent à des « boucles de pensée centrées sur soi » : narration interne, auto-jugement, ressassement ou rumination. On peut les comparer à un circuit de rétroaction où l’esprit tourne en boucle sur ses propres contenus, souvent de façon stérile ou anxiogène. ↩︎
- On distingue généralement les tentatives de suicide avérées (avec passage à l’acte et mise en danger vitale réelle), des tentatives avortées (interrompues par le sujet avant que l’acte ne devienne létal) et des tentatives interrompues (empêchées par une intervention extérieure). Cette distinction est importante pour évaluer la gravité du risque suicidaire et le pronostic clinique. La suicidologie distingue également plusieurs degrés de comportements suicidaires : idéations, gestes suicidaires sans intention létale, tentatives de suicide (avérées, avortées ou interrompues) et suicide accompli [ HAS (2022) ]. ↩︎
- Intoxication médicamenteuse volontaire. ↩︎
- Le tableau clinique évoque un trouble de stress post-traumatique complexe (TSPT-C), entité nosographique introduite dans la CIM-11 [ OMS (2019) ]. Il se définit par la présence des critères du TSPT classique, associés à des perturbations durables de la régulation émotionnelle, de l’image de soi et du fonctionnement relationnel. Le TSPT-C survient typiquement à la suite de traumatismes répétés, prolongés et interpersonnels, souvent installés depuis l’enfance. Cette catégorie n’est pas spécifiée dans le DSM-5, mais ses manifestations peuvent recouper celles d’un TSPT avec expression dissociative, dans un contexte de fonctionnement borderline post-traumatique et de dissociation secondaire. ↩︎
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) : thérapie développée par Francine Shapiro à la fin des années 1980 – et largement enrichie depuis lors – reposant sur la stimulation bilatérale alternée (mouvements oculaires, stimuli auditifs ou tactiles) associée à l’évocation contrôlée de souvenirs traumatiques, dans le but de faciliter leur retraitement adaptatif. ↩︎
- Le concept d’auto-efficacité a été introduit par Bandura (1977) et développé de manière approfondie dans son ouvrage de référence « Self-efficacy: the exercise of control » [ Bandura (1997) ]. L’empowerment, terme plus large issu des sciences sociales et de la santé publique [ Perkins & Zimmerman (1995) ], renvoie à un processus de reprise de pouvoir sur sa vie, intégrant non seulement la confiance dans ses capacités mais aussi la capacité à prendre des décisions et à agir de manière autonome dans son environnement. L’auto-efficacité constitue ainsi l’un des leviers constitutifs de l’empowerment. ↩︎